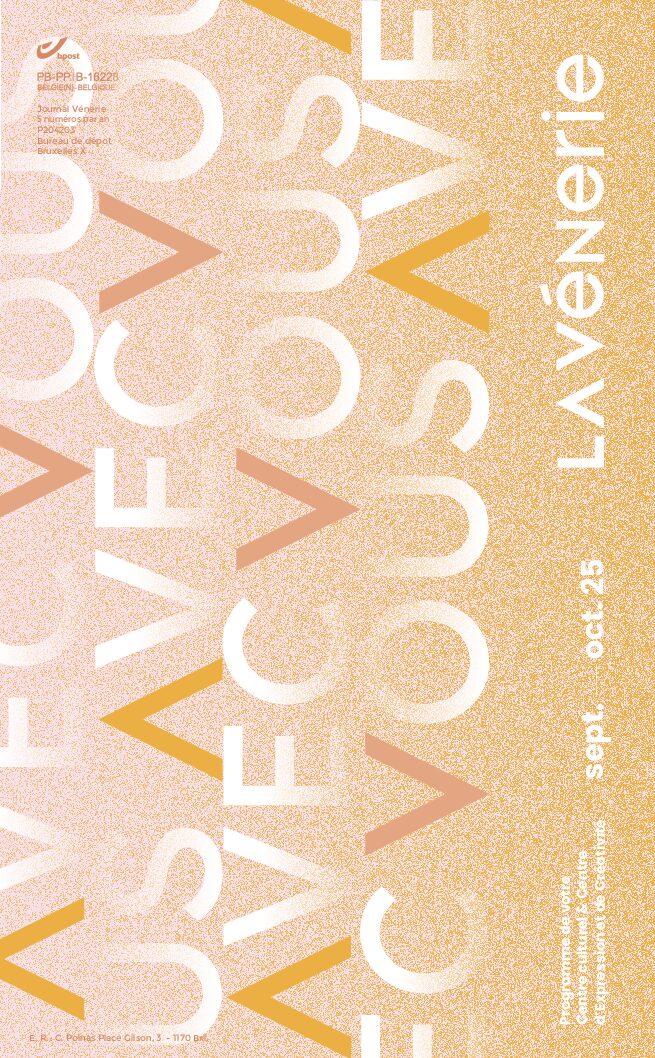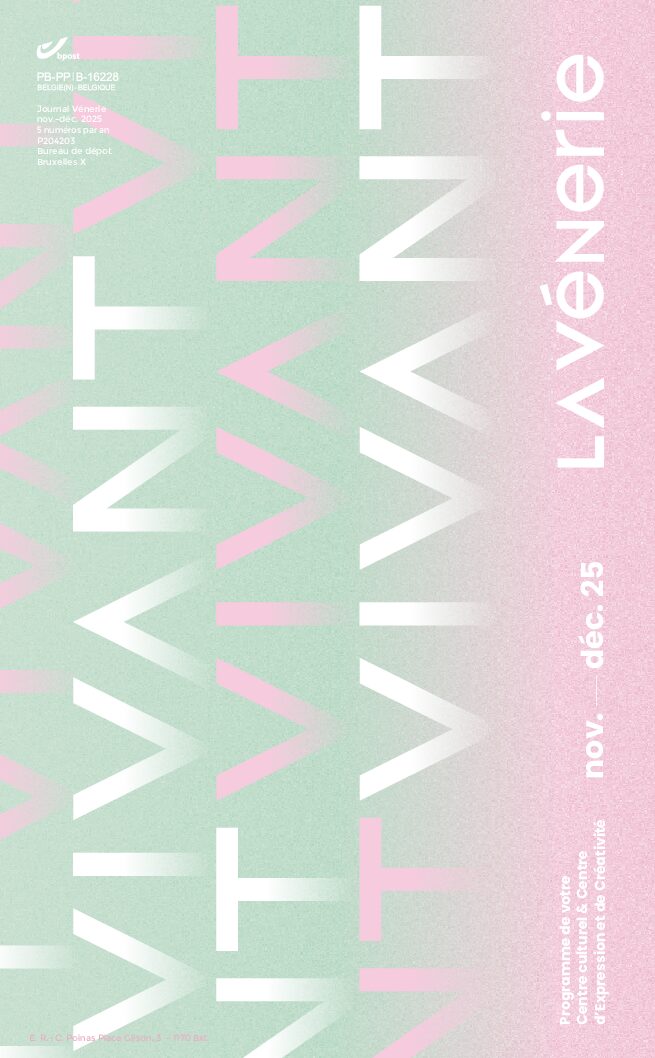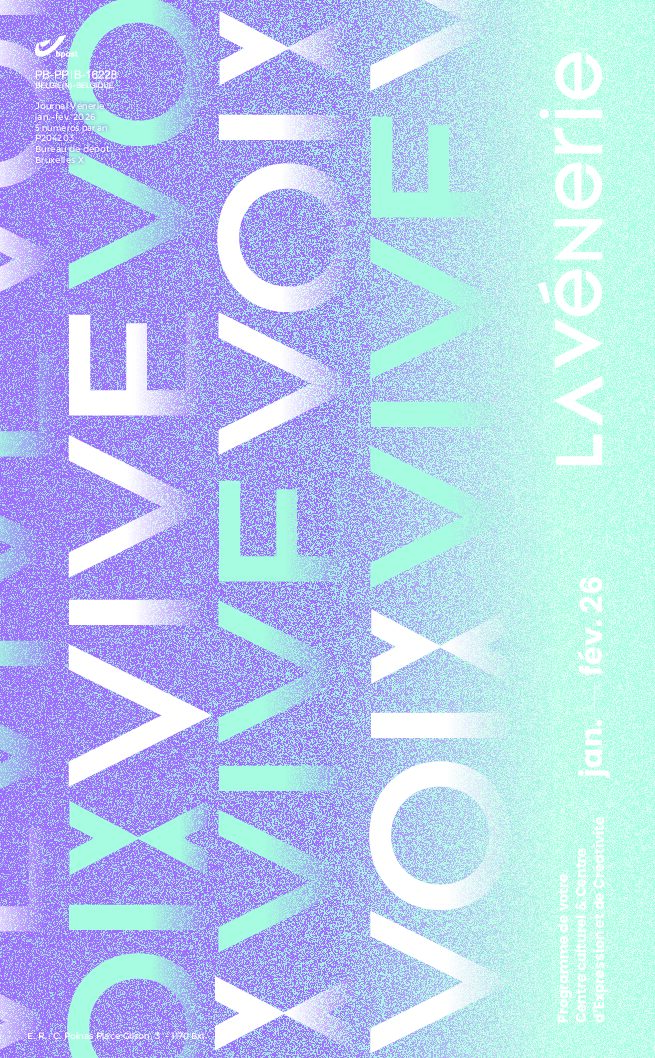Récits queer
Quel est l’impact de la culture ?
Dans le monde, les personnes queer voient leurs droits reculer. Aux États-Unis, Donald Trump affirme qu’il mettra fin au “délire transgenre”. En Hongrie, l’interdiction d’organiser ou de participer à la marche des fiertés a été votée. En Géorgie, un responsable du parti au pouvoir annonce vouloir lutter contre la “propagande LGBT”.
Sur les réseaux sociaux, Meta autorise les propos haineux s’ils sont fondés sur le genre et l’orientation sexuelle et censure les posts contenant des hashtags concernant la communauté queer. Sur X, le mot “cisgenre”, considéré comme une insulte, a été banni par Elon Musk.
La culture est également touchée, que ce soit en Autriche où le FPÖ, Parti de la liberté d’Autriche, veut supprimer les subsides aux évènements culturels dits “woke”, en Slovaquie où les responsables des institutions culturelles nationales sont remplacé·es par des bureaucrates d’extrême-droite ou encore en Pologne où les organismes culturels ont dû censurer des parties de leur programme, notamment celles qui abordent les thématiques queer, à cause de la pression du gouvernement de droite radicale.
Ces déclarations et mesures discriminatoires rappellent que les droits LGBTQIA+ ne sont jamais acquis.
Dans cette lutte, comment les institutions culturelles peuvent-elles encore faire le poids face à la montée de l’extrême droite et aux détenteurs des GAFA qui veulent imposer leur vision du monde ? Comment peuvent-elles encore agir pour faire la différence ?
Quelle importance et quel impact peut avoir une programmation culturelle autour de récits queer sur la perception du public concernant la communauté et leurs droits ?
Nous sommes allé·es interroger les artistes, intervenant·es et partenaires des rendez-vous Pride : récits queer pour recueillir leur point de vue.
La création artistique, un vecteur d’émotion plus fort que la théorie
Si les approches théoriques sont nécessaires pour mieux appréhender certaines notions et comprendre les enjeux sociétaux qui en découlent, les intervenant·es et artistes interrogé·es s’accordent toustes pour dire que la création artistique permet de toucher autrement, et souvent mieux.
Selon Samskin, artiste drag et lecteurice pour le projet Unique en son genre, “l’important, c’est de toucher profondément les gens pour leur faire comprendre intimement notre situation, notre vécu.”
“Montrer à voir et parler des ressentis queer, ça humanise bien plus la cause que ce qu’on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux”, complète Sébastien Hanesse, coordinateur du projet.
C’est ce que défend aussi Elisa Vdk, réalisatrice de Famille Choisie. Pour elle, le médium artistique et les émotions qu’il provoque est un vecteur essentiel pour transmettre un message. Les images, les témoignages, les réalisations cinématographiques, permettent de toucher autrement, “de bouleverser, de créer de l’empathie, au-delà des mots ou des théories.”
Créer des espaces d’échange
Sébastien Hanesse souligne aussi l’importance de créer des zones de parole entre les personnes sensibilisé·es à la cause queer et celleux qui ne le sont pas. Selon lui, il faudrait avoir l’opportunité de poser des questions aux personnes concerné·es pour sortir de cette zone de flou.
Samskin évoque cette lecture Unique en son genre dans un centre d’accueil pour personnes agé·es qui l’a marqué·e. “On est resté·es deux heures à parler avec elleux. Iels avaient plein de questions, et une réelle envie d’en apprendre plus. C’est tellement beau de voir que ces trois petits textes qu’on a lus ont fait germer tant de curiosité et de débats”.
Au-delà de la création artistique, iels s’inscrivent dans une démarche de médiation culturelle. Iels ne se contentent pas de présenter une œuvre : iels accompagnent sa réception, vont à la rencontre du public et ouvrent des espaces de discussion et d’écoute.
Changer les regards
Raconter, partager les récits queer permet aussi de déconstruire les stéréotypes. “Changer l’idée qu’on peut se faire des vécus queer, c’est un gros boulot, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont passé leur temps à se faire une idée bien spécifique de la chose” explique Sébastien Hanesse.
Elisa Vdk le rejoint en disant que “partager ces récits permet de déconstruire les peurs et les préjugés, de pouvoir planter une petite graine, et que les gens réalisent que, même si ce parcours n’est pas le leur, iels peuvent l’accepter, reconnaître sa légitimité et les violences subies au quotidien.”
La place de la culture
Face à la puissance des plateformes en ligne et à la violence de certains discours politiques, la culture oppose une autre forme de force : celle du lien, du dialogue, du partage des vécus.
Les propositions artistiques sont aussi un prétexte à ouvrir le débat, créer des espaces d’échanges et proposer une médiation entre les œuvres et les publics. Un travail de terrain, plus lent mais aussi plus humain, qui contribue, pas à pas, à une évolution des mentalités.
Alors que certains gouvernements oppressifs tentent d’effacer les récits queer, chaque lieu qui leur donne une place permet de préserver la diversité des voix et de maintenir le dialogue vivant. Tant qu’ils seront racontés, il restera possible de faire entendre d’autres vécus, de changer les regards et de construire une société plus juste et inclusive.
Si l’enjeu est donc toujours aujourd’hui de visibiliser les combats des communautés queer et créer le dialogue, l’idéal serait qu’un jour ces récits ne soient plus considérés comme sujets exceptionnels, qu’il ne soit plus nécessaire d’en faire un focus en mai parce qu’ils s’intégreraient naturellement au paysage culturel toute l’année, sans justification nécessaire. Qu’ils deviennent un non-sujet, parce qu’ils seraient pleinement reconnus avec la même légitimité que tous les autres récits. Rêvons à des saisons où ce type d’article ne serait plus une nécessité.
Merci à Samskin, Sébastien Hanesse et Elisa Vdk d’avoir pris le temps d’échanger et de répondre à nos questions.